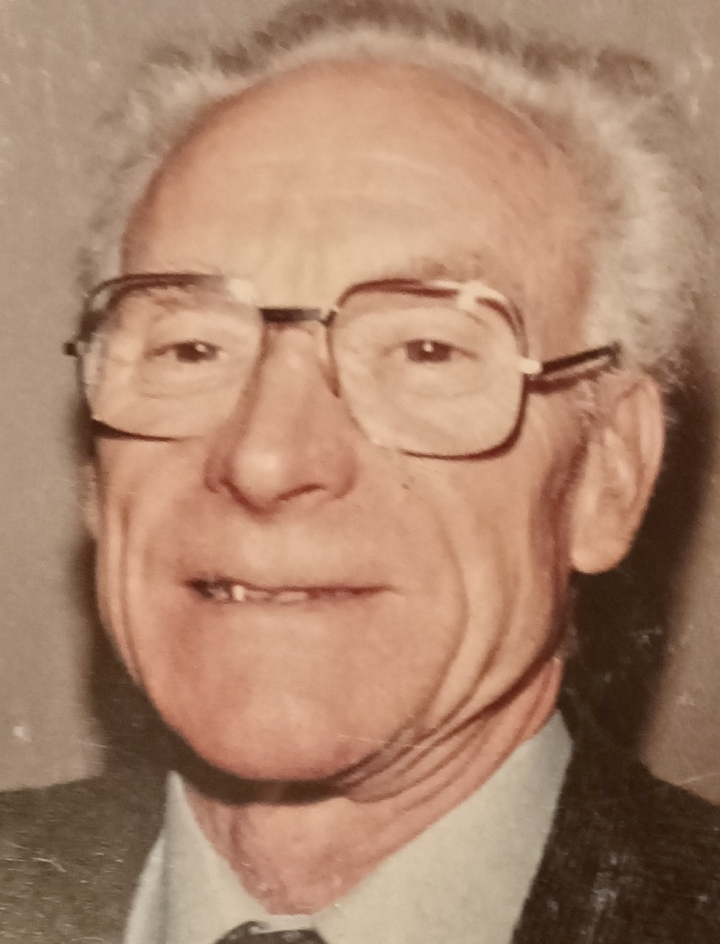© P. Neufcour
Eh oui, Saint-Nicolas est visétois depuis le 12es. Le culte du saint Nicola de Myre ou Nicolas de Bari, communément connu sous le nom de saint Nicolas, est né à Patare en Lycie (actuelle Turquie) vers 270 et mort à Myre (Turquie actuelle) en 343.
`Le culte du saint arriva dans nos régions au 12e s. et Visé fut une des premières cités à avoir une chapelle et un hôpital lui dédiés. Un peu d’explications : dans l’actuelle rue des Récollets , dans sa partie nord proche de la rue de la Chinstrée, côté Meuse, se dressa au moins dès le milieu du 13E s. un hôpital Saint-Nicolas. Cet établissement d’assistance publique était destiné aux pauvres et aux voyageurs. Donc, nullement comme on l’entend maintenant, un établissement de soins et de santé. L’établissement comprenait à ce moment une cour (ferme) et une chapelle. Dénommé « Communs pauvres », l’établissement tiendra lieu d’assistance publique jusqu’en 1737 et fut remplacé par le couvent des Récollets. Ces moines franciscains réformateurs tinrent pendant quelques dizaines d’année un collège. Vendu comme bien national, ce lieu devint la première sucrerie de notre province à l’époque française (à l’époque, c’était le département de l’OURTE – sans h)
Pourquoi les établissements dédiés à Saint-Nicolas sont-ils proches des fleuves comme on le voit à Liège, à Visé ou encore à Maastricht ?
En effet, Saint-Nicolas est devenu le patron et le protecteur des pêcheurs et des bateliers. En plus, comme on sait que Visé, devenu bonne ville de la Principauté en 1406, comprenait 3 corporations principales (en Principauté de Liège, on disait Bons Métiers) dont la plus tournée vers l’étranger était celle des Naiveurs, commerçants par bateau qui oeuvraient tant vers l’aval (la Hollande) que vers l’amont (Liège, Namur). Les deux autres étaient les vignerons et les cherwiers (agriculteurs). Il est donc normal que Saint-Nicolas soit spécialement vénéré dans notre ville mosane ;
Saint-Nicolas, patron des enfants. John Knaepen signale aussi que c’est par bateau que les cadeaux et les produits de commerce arrivaient. Sa légende d’avoir ressuscité des enfants pris dans un saloir vient bien après et explique que dans nos régions (Nord de la France, Belgique, Pays-bas), il soit si populaire, auprès des enfants. Merci Saint-Nicolas pour tous les cadeaux que tu nous offres, nous les enfants sages !!
Pour la SRAHV, Jean-Pierre Lensen