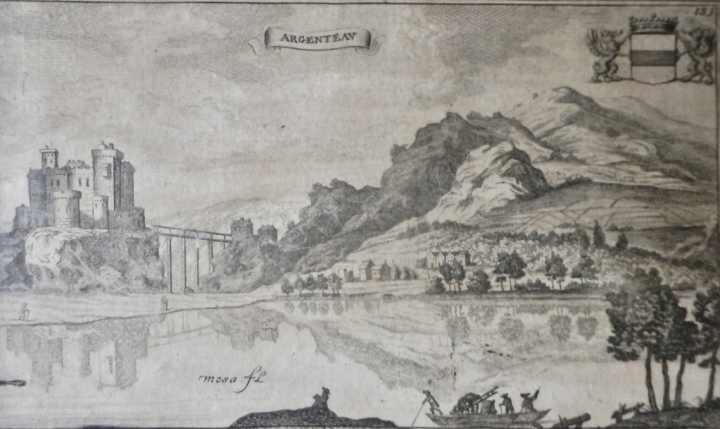Activité : visite du Musée belge de la franc-maçonnerie et le parcours maçonnique dans Bruxelles
Le programme de cette journée :
Le Musée belge de la Franc-Maçonnerie (MBFM, MBM ou M∴ B∴ M∴ en typographie maçonnique) est situé au siège du Grand Orient de Belgique, 73-75 rue de Laeken, à Bruxelles en Belgique. Le musée s'inscrit dans la continuité de celui du Grand Orient de Belgique fondé en 1985.
Le musée est installé depuis 2011 dans l'hôtel de maître néo-classique, nommé« Hôtel Dewez », en raison du nom de son architecte Laurent-Benoît Dewez. La rénovation de celui-ci fut entreprise dix ans auparavant sous l'impulsion de quatre obédiences belges.
Aujourd'hui, le musée a pour ambition de retracer l'histoire de la franc-maçonnerie en Belgique au travers de vitrines thématiques et didactiques. Par un souci d'information et d'incitation à la réflexion, le musée cherche à rendre la démarche maçonnique compréhensible.
Midi : pique-nique à emporter avec vous !
2) à 14 h30 : parcours maçonnique dans Bruxelles ( durée 1h30 à 2h00 ).
Au départ du musée, il s’agira de parcourir différents quartiers afin de découvrir les marques architecturales du symbolisme de la F.M dans le paysage urbain du centre de Bruxelles :
a) en liaison avec les choix des groupes sociaux dominants liés à la F.M. càd l’aristocratie de la fin du 18è siècle , la bourgeoisie libérale du 19è siècle ;
b) en raison de références réelles ou supposées à un symbolisme de maçons opératifs ou de compagnonnage antérieur au développement de la F.M. moderne , mais dans lesquelles certains francs-maçons voient une filiation.
Degré de difficulté : pas de difficulté mais avoir une bonne santé car nous serons debout toute la balade !
Recommandations : munissez-vous de bonnes chaussures de marche.
En cas de non-respect des consignes de sécurité (par exemple : chaussures de marche inadéquates), le Groupe Découvertes décline toute responsabilité.
Regroupement : : 8 h 40 (Horaire au 31 mai 2021), salle des pas perdus de la gare des GuiIllemins de Liège, précisément près de l’ascenseur situé devant la porte d’entrée des guichets (où l’on achète les tickets de train).
Nous nous rendrons à pied à partir de la Gare Centrale de Bruxelles au siège du Musée situé au 73, rue de Laeken (à environ 20 minutes à pied.
Drink: à midi, chaque personne du groupe aura l’autorisation de consommer son pique-nique dans la cour extérieure du musée en profitant des chaises et tables qui y sont installées , en espérant qu’il ne fasse pas trop pluvieux. Si tel était le cas, de nombreux petits restaurants, cafés et tavernes se trouvent à proximité du musée.
P.A.F: 22 + 5 € par personne (Groupe Découvertes) : ce prix correspond à votre participation à la journée organisée par le Groupe Découvertes.
Ce prix ne comprend ni le prix de vos voyages en train ou autre, ni vos repas et boissons. Je vous conseille de prendre votre Rail Pass ou de le partager avec les personnes présentes à cette activité !